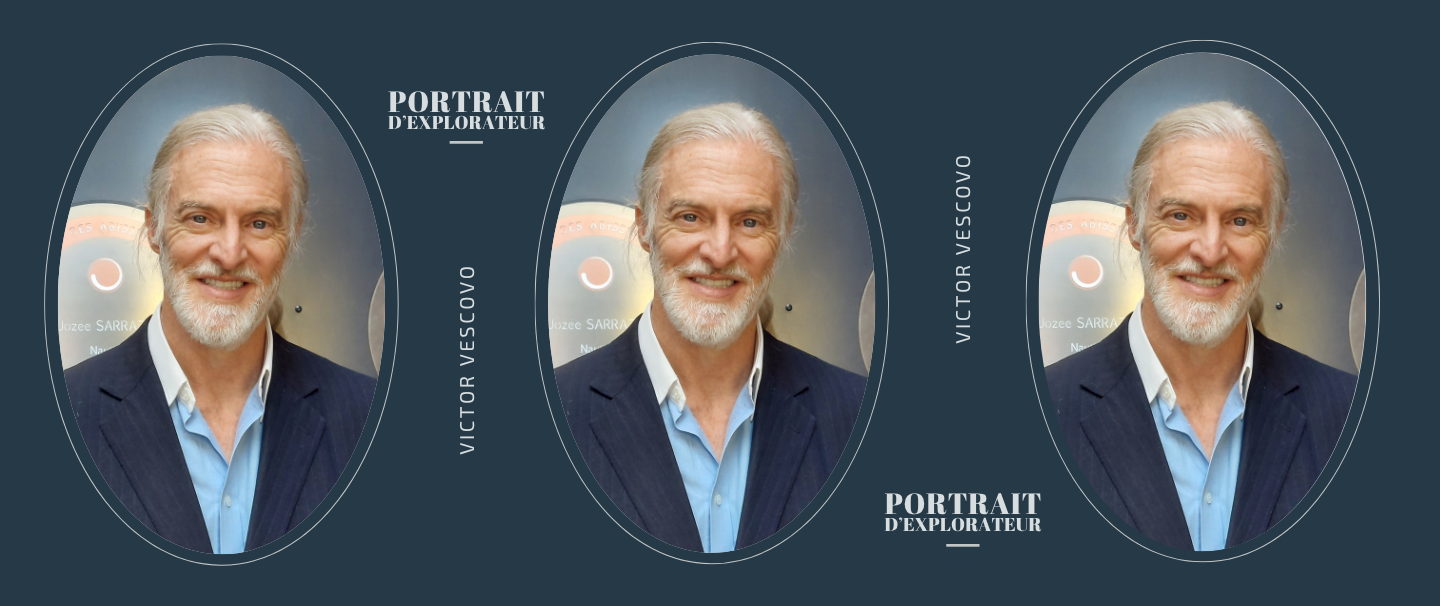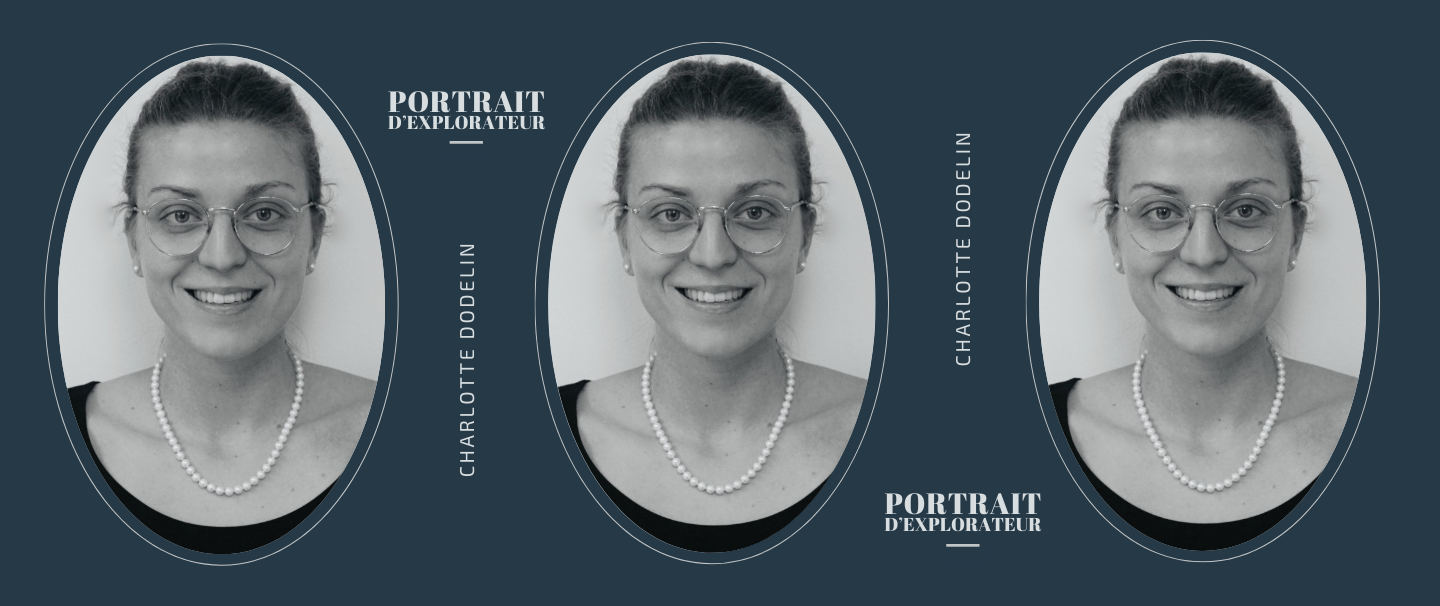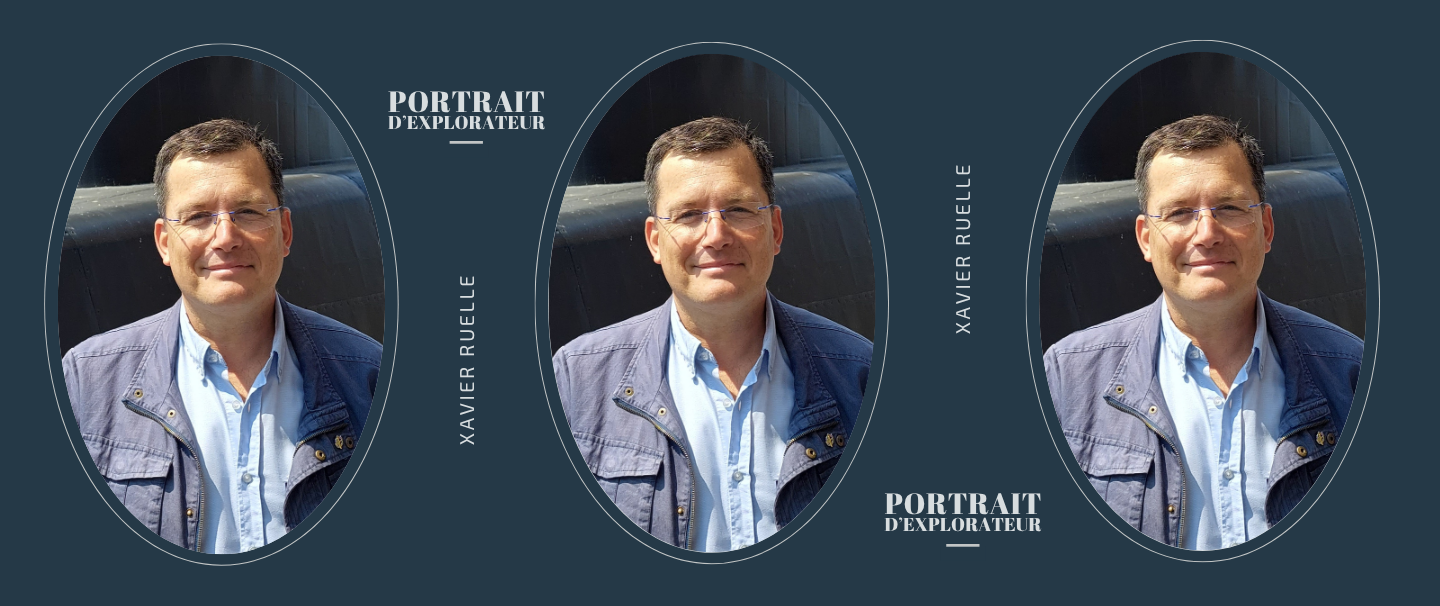Les biotechnologies au service de la santé et de l’environnement
Les chercheurs d’ALGAIA travaillent en effet l’extraction des fibres des algues pour en faire une tasse en bioplastique. Ils participent aussi au projet VARECH, en collaboration avec le laboratoire de biologie marine de l’Université de Caen-BORÉA, de valorisation d’algues échouées, en circuit court. L’objectif est d’extraire les composés biostimulants des algues afin de fortifier des plantes et les rendre résistantes aux stress hydriques, salins et pathogènes (champignons). « Des travaux ont montré que si on applique régulièrement des extraits d’algues sur les carottes de Créances, elles sont plus résistantes, on améliore le rendement et en bout de chaîne on élimine les intrants chimiques » souligne Franck HENNEQUART.
Les Laboratoires Gilbert ont déposé en 2017 un brevet de désalinisation et de concentration de certains oligoéléments d’intérêt pour des applications thérapeutiques (traitement des peaux atopiques).
Sylvie CHOPIN ajoute que « l’utilisation des ressources marines dans la recherche a un effet bénéfique sur la ressource ». Les Laboratoires Gilbert ont en effet souhaité fabriquer en circuit court leurs produits issus de l’eau de mer. Différents puisages d’eau de mer en France ont ainsi été analysés. En Méditerranée, le taux de métaux lourds était particulièrement inquiétant. Les Laboratoires Gilbert ont donc saisi les autorités pour alerter sur l’impossibilité de développer économiquement un point de puisage en raison des risques sanitaires.
Franck HENNEQUART explique qu’avec le réchauffement des eaux, les zones où se trouvent les algues évoluent : attirées par les températures élevées, certaines algues remontent et d’autres descendent pour rester dans des eaux relativement froides. Face à ce constat alarmant, ALGAIA a alerté les chercheurs de l’Ifremer.
Le monde de la recherche au service de l’innovation des entreprises normandes
L’algue est donc une ressource importante qu’il faut bien connaître et préserver explique Martine BERTRAND. Qu’elles soient minuscules ou macroscopiques, elles sont importantes car elles constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire. Mais elles sont souvent victimes d’une « intervention humaine souvent trop irraisonnée » notamment avec les pollutions par les métaux, les hydrocarbures et les plastiques. Franck HENNEQUART précise qu’avec le réchauffement des eaux, la qualité des sucres des algues se trouve quelque peu altérée.
Mais Martine BERTRAND ajoute que « le développement de l’exploitation des algues n’est pas un problème si tout est bien contrôlé ». L’aquaculture des algues est née il y a environ 30 ans pour nourrir les naissains de mollusques dans des écloseries. Pour en arriver là, les scientifiques ont cherché à comprendre leur cycle biologique et ont découvert que les macroalgues passaient par un stade microscopique. Leurs cultures et leurs gestions ont ainsi pu être maîtrisées.
L’industrie normande et la mer
« Notre dada à nous, c’est la récolte du vent » déclare Erwan LE FLOCH, directeur de l’usine de Cherbourg du groupe danois, LM Wind Power. En 1978, les pales de LM Wind Power ne mesuraient que 7 mètres. Elles ont progressivement grandi pour être toujours plus productives. Elles mesurent aujourd’hui 107 mètres. Ce sont les pales les plus grandes du monde. L’objectif est de « gagner la bataille de l’énergie », c’est-à-dire d’être en capacité de produire de l’énergie renouvelable à un prix compétitif par rapport aux autres énergies de « façon à ce que l’énergie renouvelable face tomber la barrière du coût de l’énergie ».
Erwan LE FLOCH explique le rôle primordial que joue ici la mer : « Le taux de charge d’une éolienne à terre, c’est-à-dire le temps où elle va tourner à pleine puissance, est de 25 %. Avec une éolienne composée de pales de 107 mètres, le taux de charge passe à 63 %. C’est pourquoi, la mer est très importante dans ce type d’industrie car elle permet de réduire l’intermittence et donc d’augmenter le taux de charge ». La quantité d’énergie produite par une seule éolienne de LM Wind Power fournit plus de 16 000 foyers. Erwan LE FLOCH ajoute que « cinq éoliennes au large de Cherbourg-en-Cotentin pourraient fournir en électricité tous ses habitants ».
Le choix d’implantation de la 15e usine du groupe à Cherbourg est également stratégique : le port est au centre des principaux marchés de l’éolien en mer : mer du Nord, Royaume-Uni, Irlande et « peut-être la France avec un développement futur de parcs éoliens offshore ». De plus, construites sur le port, les pales sont expédiées directement par la mer car le transport par la route est impossible.
Les métiers de la mer
Pour découvrir les métiers de la mer, Martine BERTRAND invite les jeunes à se rendre aux portes ouvertes d’Intechmer où ils peuvent s’informer auprès des étudiants. Intechmer propose en effet trois formations professionnalisantes en trois ans accessibles avec un bac scientifique. Elle souligne également « qu’une des particularités des Intechmériens est de trouver du travail partout dans le monde ».
Sylvie CHOPIN indique que les scientifiques de son laboratoire possèdent de bac+5 à bac+10 mais qu’il y a également des techniciens diplômés d’un BTS « qui réalisent toutes les expérimentations qui vont faire avancer la recherche » et du personnel issu des écoles de commerce « qui étudient les attentes des consommateurs ». De très nombreux métiers sont proposés à l’usine LM Wind Power de Cherbourg informe également Erwan LE FLOCH : en production (habilité manuelle), industriel, logistique, qualité, finance et engineering.
Quoiqu’il en soit, ce qui réunit ces quatre intervenants autour de cette table est leur passion commune pour la mer mais aussi la curiosité et le goût du travail. Martine BERTRAND est tombée amoureuse de la mer à l’adolescence et son intérêt pour les algues est né de la rencontre avec une professeure de biologie à l’université « passionnée et passionnante » qui lui a ouvert les portes. Tandis qu’un ami de la famille d’Erwan LE FLOCH l’a encouragé : « Erwan, quoi qu’il arrive, fait le maximum pour aller le plus loin possible dans tes études et ça t’ouvrira des portes ».
Ce qui anime Sylvie CHOPIN, c’est « la création de nouveaux produits ». Elle effectue une veille bibliographique sur les recherches fondamentales qui lui permet de voir les tendances qui se dessinent et de « faire des propositions ». Elle ajoute que dans son service Recherche et Développement les 18 employés (chimiste, pharmacien, biochimiste…) ont des parcours très différents mais qu’ils sont tous d’une grande polyvalence et qu’ils ont en permanence la « volonté de créer et d’innover ».
Franck HENNEQUART et Martine BERTRAND insistent enfin sur le fait « qu’il faut être très curieux ».