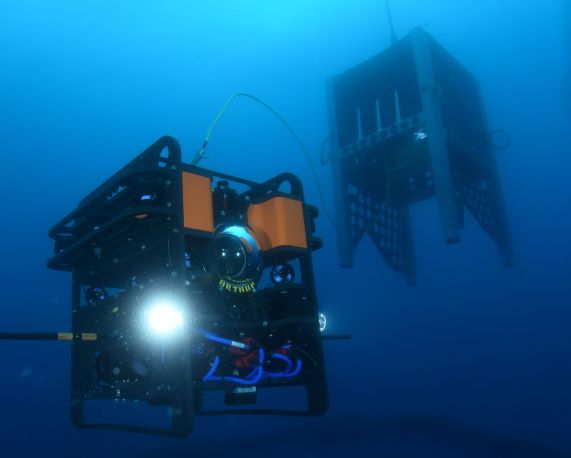L’indéniable toxicité des déchets plastiques
Ika PAUL-PONT, spécialiste en écotoxicologie au CNRS, et Arnaud HUVET, spécialiste en physiologie moléculaire des bivalves marins à l’Ifremer, ont étudié l’effet des déchets plastiques sur l’océan et sa faune dans la rade de Brest.
C’est au sein du Laboratoire des sciences de l’environnement marin (Lemar) qu’ils ont effectué leurs recherches.
Selon PAUL-PONT, 80% des déchets proviennent de la terre, mais ce pourcentage reste variable selon les régions. Ces déchets sont ensuite colonisés par les microbes et sont, de ce fait, « propices à la dispersion des espèces de micro-organismes », particulièrement ceux qui sont dangereuse pour l’humain.
Pour comprendre la toxicité du plastique, PAUL-PONT et HUVET ont travaillés sur les 16 000 composés chimiques associés aux plastiques. Si l’on ignore de quoi ils sont faits, les scientifiques ont tout de même pu en déduire qu’environ 25% sont « jugés préoccupants » et que 6% « font l’objet d’un suivi par une réglementation européenne ».
Leurs effets ont pu être constaté sur les huîtres, à chaque stade de développement, au sein de la station expérimentale d’Argenton, dans le cadre de la thèse de Domitille ALADJIDI sur la toxicité des nanomatériaux sur laquelle a travaillé Ika PAUL-PONT.
Les naissains d’huîtres sont exposés à une pollution plastique dans les mêmes conditions que celles projetées par le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) d’ici l’an 2100 – dans le cas où rien ne viendrait à changer.
Une analyse comparative des effets de trois plastiques – le polystyrène conventionnel, le PLA et le PHBV – sera réalisée.