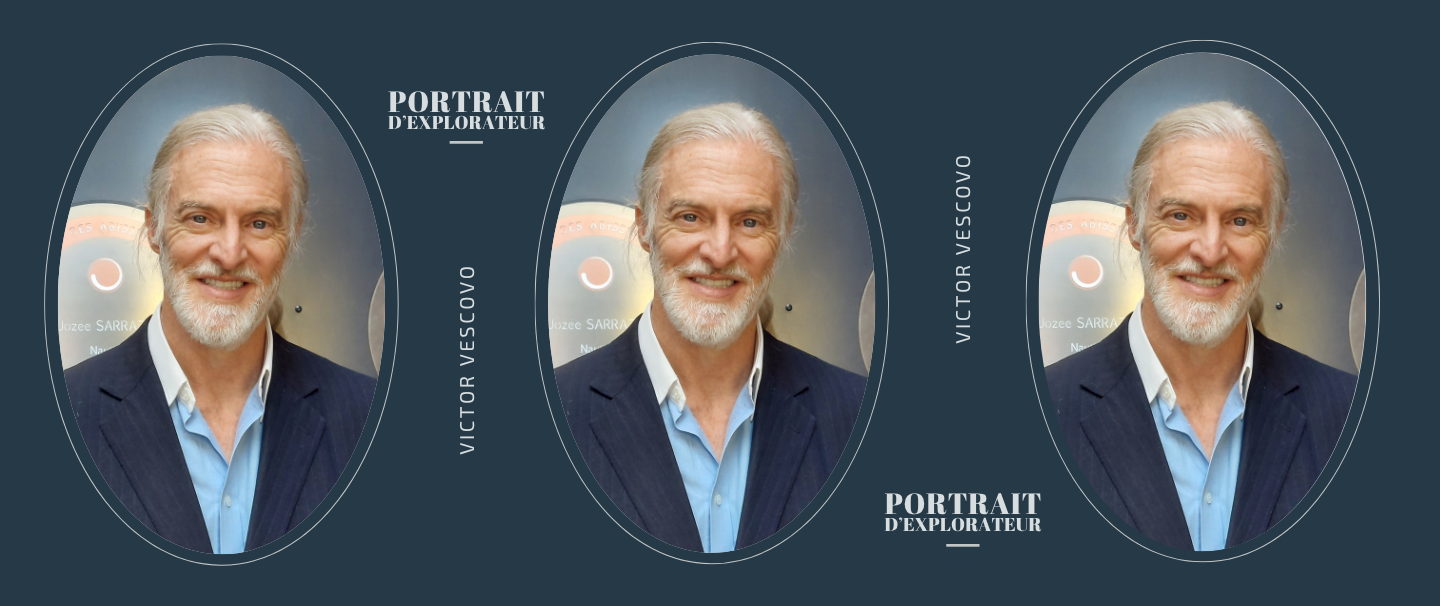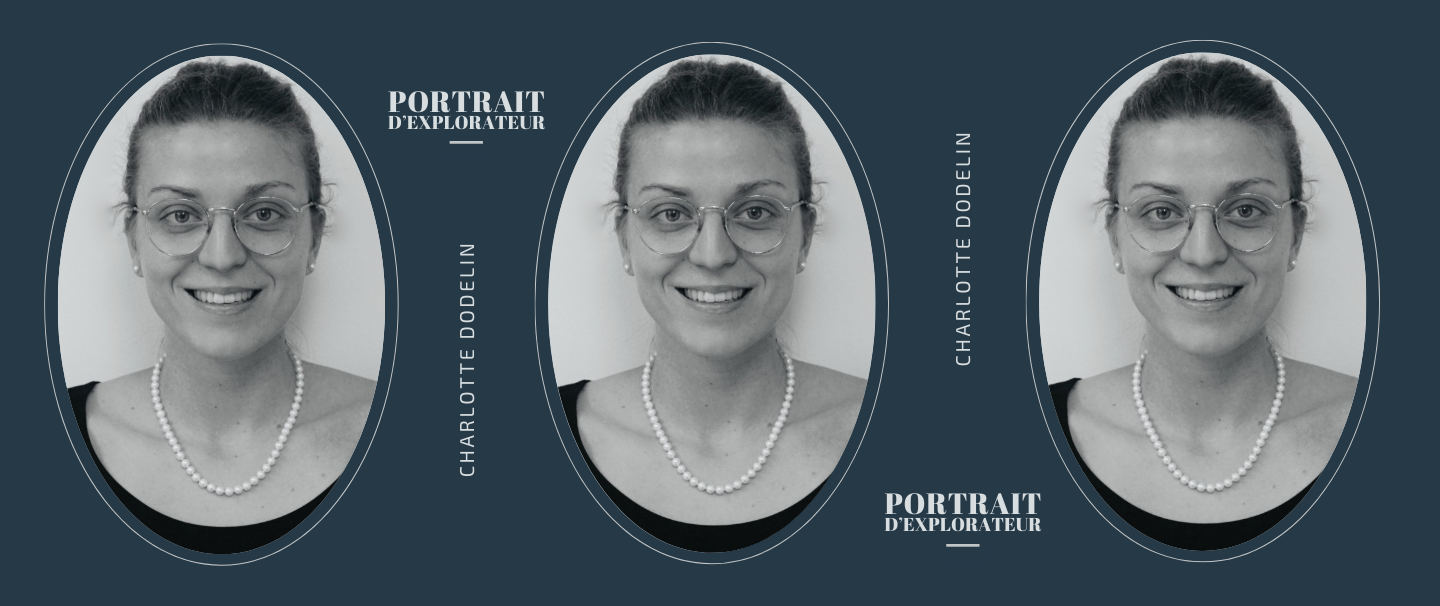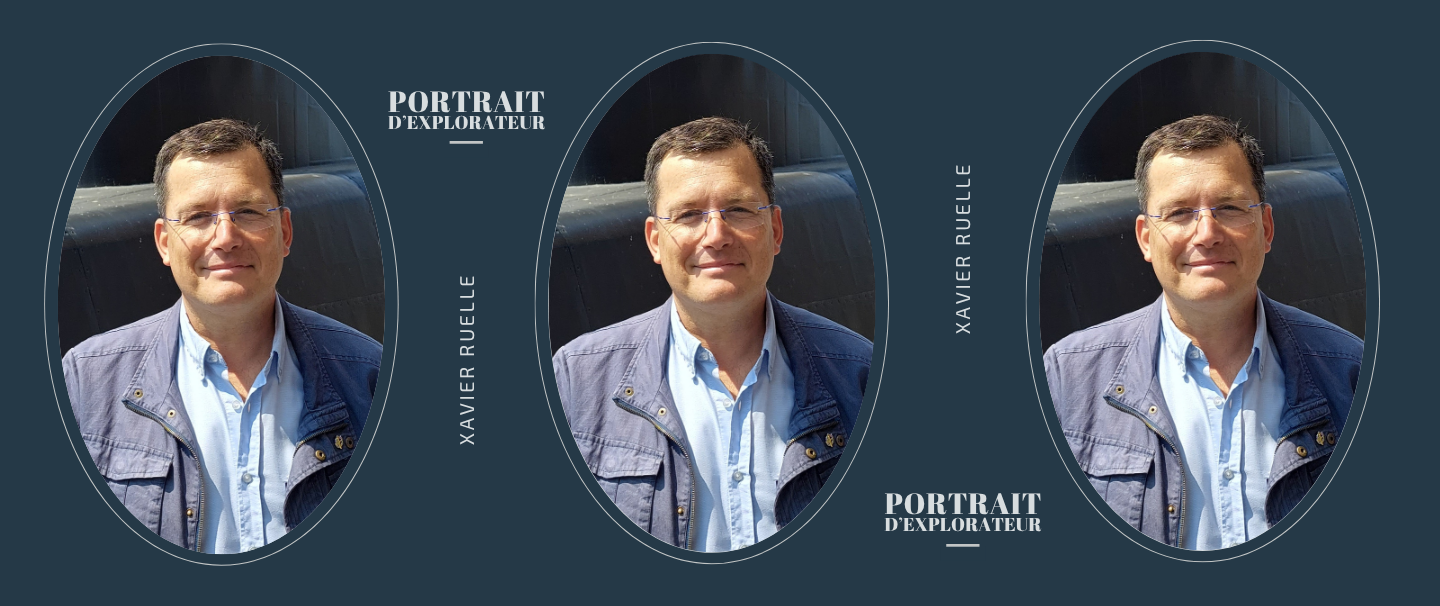La découverte, en 1995, aux portes de Saint-Malo, des épaves de 2 grandes frégates corsaires englouties au pied des écueils de la Natière a permis, après 10 années d’enquête archéologique sous-marine, de dévoiler un pan oublié de la guerre de course.
La plus ancienne de ces épaves, La Dauphine, est une grande frégate de 300 tonneaux, construite au sein de l’arsenal royal du Havre en 1703, par le charpentier COCHOIS. Commandée par le capitaine Michel DUBOCAGE, elle escortait une prise anglaise, le Dragon, lorsqu’elle s’est perdue, le 11 décembre 1704, à l’entrée de Saint-Malo.
La seconde, identifiée comme la frégate de 400 tonneaux L’Aimable Grenot, a été construite à Granville par un armateur privé, Léonor COURAYE DU PARC. Initialement armée pour faire la guerre de course, avant d’être reconvertie au commerce, elle s’est perdue le 7 mai 1749 alors qu’elle quittait Saint-Malo « pour le voyage de Cadix, chargée de toiles et autres marchandises du dit lieu ».